Le Programme thématique de recherche (PTR) Gouvernance et Développement (PTRC-GD) lance un Appel à contribution pour un ouvrage collectif sur le thème : » Théorie générale de la gouvernance politique «
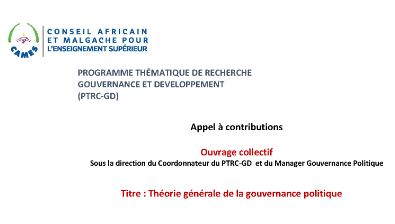
1/ Argumentaire
Dans un souci d’amélioration constante et de valorisation innovante de la recherche, le Plan Stratégique de Développement du CAMES (PSDC) « ambitionne en général, dans ses sept (7) orientations stratégiques, et en particulier dans les actions suivantes : mettre en place un système d’information pour les programmes, améliorer la gouvernance des programmes ; soutenir et valoriser la formation ; promouvoir le développement des écoles et formations doctorales dans l’espace ; accroitre l’impact de la recherche »
En application d’une des recommandations de la dernière Assemblée des membres des Programmes Thématiques de Recherche du CAMES (PTRC), le Secrétaire Général du CAMES a pris un Arrêté portant nomination des membres des Bureaux des PTRC et de leurs points focaux nationaux, conformément aux différents consensus dégagés dans chacun des PTRC, lors des 4ème Journées Scientifiques du CAMES (JSDC-4), tenues à Ouidah, au Bénin en décembre 2019. Cet acte devenait nécessaire pour donner de la légitimité aux différents animateurs des PTRC tant au niveau national qu’international. En effet le concept de PTRC ne tient que dès lors qu’il existe bien une coordination, dans un domaine donné de la recherche, à la fois au plan national et international.
C’est en cela que se trouve la pertinence et la spécificité de la recherche menée dans le cadre des PTRC et, par voie de conséquence, de la qualité des résultats attendus. Dans ce contexte, le PTRC-GD lance le projet d’un ouvrage collectif sur la théorie générale de la gouvernance, sous la forme d’outils d’aide à la décision.
Toute organisation humaine est portée, de manière consciente ou inconsciente, par une forme de gouvernance. Il est désormais de notoriété médiatique que partout dans le monde, les organisations humaines, qu’elles soient privées, publiques ou civiques, prennent elles-mêmes la barre pour se gouverner. La valorisation du concept de gouvernance ces dernières années est sans doute liée à la prise en compte du pouvoir politique dans l’analyse économique d’une part, et du lien entre l’État, la société civile et le marché d’autre part.
Avant d’être un ensemble de connaissances systématisées en vue de la gestion d’un domaine quelconque de l’existence humaine, la gouvernance est essentiellement le rassemblement mesuré des éléments qui, se tenant chacun en son lieu propre, permettent la cohésion de l’ensemble, dans un mouvement harmonieux. Elle est le site de l’innovation sociétale et du dynamisme de développement humain, car elle est structurée autour des pratiques interdépendantes et des représentations des acteurs impliqués dans le processus de prise de décision, et de l’action des divers niveaux de pouvoir.
Gouverner, du point de vue étymologique, est synonyme de naviguer. Il s’agit de conduire les mécanismes, les processus, les relations et les institutions au moyen desquels les groupes humains articulent leurs intérêts, exercent leurs droits et assument leurs obligations. En ce sens, la gouvernance, en quelque domaine que ce soit, implique toujours le cheminement guidé d’une société, selon au moins trois dimensions de l’existence, à savoir la dimension identitaire, la dimension matérielle et la dimension organisationnelle.
Du point de vue identitaire, toute société assume une dénomination et une histoire, occupe un territoire délimité, territoire qu’il porte sous forme de représentation mentale ou de conscience d’appartenance à un lieu. C’est par cette représentation mentale que le groupe humain s’approprie son lieu d’existence et fait valoir son identité au regard des autres.
Du point de vue matériel, la gouvernance d’une société prend en compte l’épanouissement dans l’espace et le temps, de sorte que la mesure (en termes de qualité et de quantité) d’une gouvernance s’effectue avec des indices spatiotemporels.
Du point de vue de l’organisation, la gouvernance comporte des traditions et des institutions par lesquelles l’autorité est exercée au niveau politique, économique, administrative, et le cadre réglementaire, dans la gestion des affaires d’un groupe humain.
La théorie générale de la gouvernance à exposer dans cet ouvrage a un objectif englobant, celui de la recherche fondamentale. Il s’agit d’analyser et d’interpréter, de manière scientifique et normative, les principes qui permettent aux êtres humains de conduire leurs activités individuelles, politiques, économiques, sociales et culturelles dans le monde en général, et en Afrique en particulier. Si le monde s’entend comme l’ensemble constitué par les activités humaines et les biens consommables d’une part, les représentations mentales (images-souhaits) qui conditionnent et orientent les groupes humains d’autre part, habiter le monde appelle sa gestion et sa transformation.
La notion de théorie générale se justifie par le fait que nous posons la gouvernance comme un phénomène humain, en vue de le décrire, de l’expliquer, de le comprendre, d’évaluer et de prédire le devenir des sociétés humaines, selon trois moments, considérés comme des lois à partir desquelles la théorie est déduite. Il s’agit de la loi du fondement, de la loi de l’évaluation et de la loi systémique.
La loi du fondement de la gouvernance générale poursuit trois objectifs :
- Établir les normes éthiques de l’action de gouverner ou de diriger politiquement une société ou l’éthique de la gouvernance politique. Une telle éthique normative fonde l’art de gouverner, c’est-à-dire l’ensemble des habiletés politiques et administratives, ainsi que des pratiques juridiques et coutumières qui permettent de faire fonctionner l’État, ses organes et ses institutions, et tout autre type de société ;
- Formuler une éthique de la constitution à partir de laquelle le régime politique trouve sa nature propre, les gouvernants tirent leur légitimité, et l’interprétation que ces gouvernants font du texte fondateur dans leur pratique de tous les jours.
- Proposer une métaphysique de la division des pouvoirs aux différents organes de l’État qui assurent la direction du pays, c’est-à-dire les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires tous ensemble.
La loi de l’évaluation de la gouvernance vise à :
Examiner la distribution des droits, des obligations et des pouvoirs qui soutiennent les organisations humaines ; étudier des modes de coordination qui sous-tendent les diverses activités d’une organisation et qui en assurent la cohérence ; explorer des sources de dysfonctionnement organisationnel ou d’inadaptation à l’environnement qui aboutissent à une performance limitée; établir des points de référence, la création d’outils et le partage de connaissances, afin d’aider les organisations à se renouveler lorsque leur système de gouvernance accuse des lacunes ; proposer le calcul de l’indice de la gouvernance générale (IGG) sur la base de l’indice de la moralité des gouvernants (IMG) et de l’indice de la gouvernance nationale (IGN).
La loi systémique de la gouvernance générale vise à :
Établir le principe de gouvernement par la base, à travers lequel le système gouverné commande le système gouvernant, en un gouvernement populaire ou direct. Une telle loi a pour objet d’insérer un gouvernementalisme au sein du parlementarisme. En effet, l’histoire des idées politiques enseigne que le rapport entre un citoyen et son gouvernement est basé sur une relation de nature contractuelle entre un mandant et son mandataire, de sorte que là où le mandataire a été dûment et démocratiquement élu, le citoyen ne devrait pas être fondé à contester son gouvernement tant que celui-ci opèrerait dans la légitimité et la légalité.
Nous introduisons le concept de gouvernement populaire, qui consiste à fonder le pouvoir exécutif à partir du peuple. Cela implique la prise en compte des éléments suivants dans les textes fondamentaux : la doctrine et l’institution ; les niveaux ou espaces d’application ; les acteurs impliqués ou les parties prenantes ; la dimension historique et culturelle du groupe humain ou du pays.
Les résultats de l’analyse du concept de gouvernance dans cet ouvrage sont articulés aux donnés du développement humain. La notion de développement ne prend un sens que par rapport à des jugements de valeur qu’il est préférable d’expliquer, car elle implique une comparaison : le développement n’apparaît comme tel que dans une opposition ou un jeu de contraste avec le sous-développement, qui serait son niveau inférieur. Il y aurait ainsi un niveau inférieur, sous le développement, caractérisé par une insuffisance sociétale globale de bien-être. Mais quel serait le critère de l’accession au développement ? Est-il possible d’envisager, au niveau purement théorique, un état de société développé ?
En son essence propre, le développement doit conduire à la question de l’avenir et du devenir des sociétés humaines, en tant que réalité plurielle qui intègre tous les aspects de l’être au monde, avec le souci d’éliminer la pauvreté, et permettre la prospérité de tous les pays du monde. Pour échapper à la tentation de compenser le réalisme politique par un idéalisme moral, il s’agit de penser la gouvernance politique autrement, en indiquant la trace du désintéressement de soi qui clignote toujours et déjà dans l’économie historiquement ambiguë des négociations politique.
2/ Axes de réflexion
- Approche philosophique et éthique de la gouvernance politique
- Approche territoriale et sociale de la gouvernance politique
- Approche économique et financière de la gouvernance politique
- La gouvernance des Universités à l’épreuve du COVID-19.
3/ Modalités de soumission
Les propositions d’articles seront envoyées sous la forme complète, avec un résumé d’environ 400 mots en Français et en Anglais, accompagné d’une présentation de(s) (l’) auteur(e)(s) (statuts, institution de rattachement, thèmes de recherche, adresse électronique), au Manager Gouvernance Politique : claver.boundja@umng.cg ; avec copie au Coordonnateur du PTRC-GD : bahhenri@yahoo.fr .
Les articles, en plus d’être rédigés selon les normes du CAMES en Lettres et Sciences Humaines, doivent avoir la structure suivante :
- Introduction
- Méthode
- Résultats
- Discussion
- Conclusion
- Références bibliographiques
4/ Calendrier
- Ouverture de l’appel à contributions : 7 février 2020
- Date limite de réception des propositions : 31 juillet 2020
- Notification aux auteurs : 8 août 2020
- Publication : 0ctobre 2020, Collection Études Africaines, Série Politique, l’Harmattan-France.
5/ Frais de participation
Sont à déterminer après la publication, selon la facture de l’Harmattan (plus ou moins 30 000 Fcfa, qui donnent droit à un exemplaire de la version papier et électronique de l’ouvrage).
